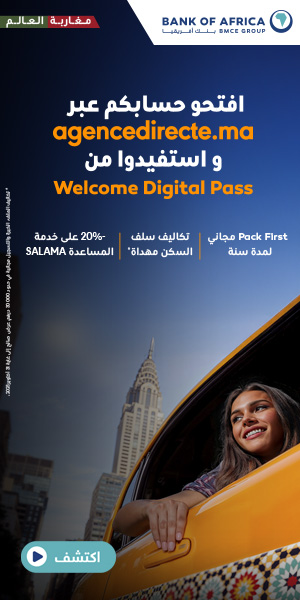Ils rentrent au pays après des années passées à l’étranger, porteurs d’un savoir-faire acquis loin de chez eux, avec l’envie de contribuer, mais aussi le besoin de se réinventer. Les Marocains du monde qui choisissent de revenir posent les jalons d’un retour encore trop peu balisé, entre volonté d’ancrage et réalité du terrain.
Leurs parcours, au croisement de plusieurs mondes, ne se limitent pas à une relocalisation géographique. Ils composent avec des attentes, des défis, des réseaux, et une identité multiple. Une récente étude conjointe du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et de l’Université Internationale de Rabat en dresse un état des lieux, en se concentrant sur deux sphères particulièrement dynamiques : l’enseignement supérieur et l’entrepreneuriat.
Depuis les discours de S.M le Roi Mohammed 6 en 2022 puis en 2024, les compétences issues de la diaspora sont placées au cœur du projet national. Leur mobilisation est désormais perçue comme un levier stratégique, non seulement économique, mais aussi social et culturel. Mais entre cette ambition affichée et les trajectoires concrètes des personnes qui franchissent le pas du retour, l’écart reste significatif.
Les profils étudiés sont très qualifiés, souvent jeunes, de plus en plus féminins, et majoritairement formés dans des univers multiculturels. Leur motivation est rarement purement économique. Nombreux sont ceux qui évoquent un attachement au pays, un désir de transmission, ou l’envie de participer à une dynamique de transformation. Mais une fois sur place, ils se heurtent à des logiques parfois rigides, des lenteurs administratives, et des systèmes peu adaptés à la pluralité de leurs parcours.
Dans le monde académique, les établissements les plus ouverts à ces profils sont ceux qui articulent partenariat public et gestion privée. Ils offrent davantage de souplesse pédagogique, une orientation internationale affirmée, et des passerelles entre langues, cultures et méthodes. Ce sont souvent ces structures qui permettent aux Marocains du monde de retrouver un espace d’expression professionnelle cohérent avec leur trajectoire.
Côté entrepreneuriat, la créativité est bien là, portée par une expertise technique solide et une vision managériale souvent très structurée. Mais là encore, la confrontation avec le réel n’est pas toujours simple : accès au financement difficile, procédures peu lisibles, manque de dispositifs pensés pour des projets nés à l’étranger. Pour s’en sortir, beaucoup misent sur leurs réseaux, activent des relais informels, ou importent des pratiques d’organisation plus souples.
Face à ces constats, les auteurs de l’étude plaident pour une stratégie mieux structurée. Ils évoquent la création d’une fondation dédiée aux Marocains du monde, qui servirait de plateforme pour l’accompagnement, l’orientation et la coordination des projets. L’idée serait de relier les institutions publiques, le tissu économique et les initiatives de la société civile, dans une logique de co-construction.
À cela s’ajouterait une diplomatie scientifique et entrepreneuriale, avec des incubateurs, des programmes de mentorat, des fonds spécifiques et des hubs de recherche capables de canaliser l’apport de la diaspora. Car pour que ces retours soient autre chose que des expériences isolées, il faut repenser les cadres. Cela suppose aussi de valoriser toutes les formes de compétences, y compris celles qui ne sont pas académiques, et de reconnaître pleinement la richesse des appartenances plurielles.
L’enjeu dépasse la simple réinsertion. Il s’agit de construire un lien durable, structurant, entre le Maroc et sa diaspora. Cela passe par des mesures concrètes, des politiques coordonnées, des pilotes agiles, mais aussi une vision à long terme. Les Marocains du monde ne demandent pas seulement à être utiles. Ils veulent compter.